Interview Président CPP – 10.04.2020
Les Comités de Protection des Personnes (CPP) : missions durant et hors période de crise sanitaire & rôle des représentants des usagers (RU)
 Interview du Professeur Bettina Couderc, Présidente du Comité de Protection des Personnes Sud-Ouest Outre-Mer 2 – CPPSOOM2[1]. Les deux CPP toulousains (CPPSOOM 1 et 2) font partie des CPP habilités à évaluer des essais cliniques européens Covid-19.
Interview du Professeur Bettina Couderc, Présidente du Comité de Protection des Personnes Sud-Ouest Outre-Mer 2 – CPPSOOM2[1]. Les deux CPP toulousains (CPPSOOM 1 et 2) font partie des CPP habilités à évaluer des essais cliniques européens Covid-19.
Le rôle des Comités de Protection des Personnes – CPP
Quel message souhaiteriez-vous faire passer sur le rôle des CPP notamment dans ce contexte de crise sanitaire inédite ?
Lorsque des investigateurs cliniques veulent réaliser des essais cliniques en France, ils doivent présenter leurs projets à deux Instances que sont L’Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des Produits de Santé (ANSM) et un CPP. Les deux Instances vont évaluer l’essai séparément, en parallèle, et elles doivent toutes les deux donner un avis favorable pour que l’essai clinique ait lieu. Il y a 39 CPP en France, 17 sont agréés européens dont les deux toulousains.
En CPP, l’on s’attache à la protection du patient au travers notamment de l’évaluation de la notice de présentation de l’essai qui va être lue par le patient afin qu’il puisse donner un consentement dit « éclairé ». Cela implique que le patient ait compris les tenants et aboutissants de l’essai clinique comme les médicaments qu’il va prendre ou non, les analyses sanguines et la radiologie auxquelles il va se prêter, etc. L’on s’intéresse donc à ce que la notice d’information corresponde fidèlement au protocole, c’est à dire à ce qui est prévu par les médecins, qu’elle soit claire et loyale.
En outre, le consentement du patient doit être libre, il ne doit pas subir de pression lorsque le médecin va lui présenter l’essai. Le médecin doit laisser un temps de réflexion suffisant au patient et n’exercer aucune pression afin que ce dernier se sente libre d’accepter ou de refuser.
Par ailleurs, dans le CPP des méthodologistes vont vérifier toute la méthodologie et les analyses statistiques. Ils s’intéressent notamment, à la cohorte, au nombre de patients à inclure dans l’essai clinique afin de pouvoir mettre en évidence un effet significatif sur une population témoin, par exemple : trop peu de patients ne permettraient pas de répondre à l’objectif de l’essai. L’ensemble des membres va évaluer l’adéquation entre l’objectif de l’essai, par exemple : « est-ce que cette molécule a un effet thérapeutique ou pas » et les critères d’évaluation prévus. Ils doivent répondre aux questions : « l’essai est-il justifié ? est-il réalisable ou pas ? est-ce que les méthodes d’évaluation de l’état de santé du patient sont adaptées pour répondre à la question posée ? est-ce que les populations vulnérables sont bien protégées ? est-ce que la balance bénéfice/risque est en faveur du patient ? « , etc.
Le protocole de recherche est ainsi passé minutieusement en revue, par exemple : « y a-t-il des prises de sang ? combien ? le nombre est-il suffisant ou trop important ? », etc. Les volets éthiques et scientifiques sont étudiés avec autant d’importance, la priorité étant toujours la protection du patient.
L’impact de la crise sanitaire actuelle sur les essais COVID
Les CPP sont-ils consultés en « urgence » en cette période de crise sanitaire afin de rendre des avis sur les conditions de validité des projets de recherche liés au COVID-19 ?
Oui, en cette période de crise sanitaire les CPP sont d’avantage consultés. Habituellement, les CPP se réunissent tous les mois, il y a deux séances par mois : une séance plénière et une séance en comité restreint. Ils évaluent une dizaine de protocoles par mois à des dates précises connues de la Direction Générale des Soins (DGS). Pour le CPPSOOM2 ce sont les deux premiers jeudis de chaque mois.
Classiquement, l’attribution des dossiers se fait par tirage au sort après dépôt sur le site national géré par le système d’information des recherches impliquant la personne humaine (SI RIPH). Les dossiers sont répartis aléatoirement entre les CPP. La différence dans les cas COVID compte-tenu de l’urgence, c’est que la DGS contacte les Présidents des CPP et demande s’il est possible d’ajouter plusieurs dossiers supplémentaires sur l’une des réunions prédéfinies ou la faisabilité pour le CPP de mettre en place une réunion extraordinaire pour traiter des dossiers COVID.
En temps de COVID, beaucoup de médecins veulent tester des nouveaux médicaments et surtout repositionner des anciens médicaments pour cette nouvelle indication, c’est l’exemple de l’hydroxychloroquine, mais aussi des antiviraux, etc. Ces médecins souhaitent monter un essai clinique afin de vérifier si leur hypothèse est bonne et les CPP sont saisis « en urgence » par la DGS, c’est le cas du CPPSOOM2. Le Président mobilise les membres du Comité qui reçoivent les dossiers, les évaluent, se réunissent et rendent un avis sous une semaine, cinq dossiers en une semaine pour le CPPSOOM2 entre le 5 et le 10 avril 2020. Ceci pour que la recherche clinique française soit la plus dynamique possible et que les CPP ne soient pas un frein à la recherche. Il y a un élan national de tous les CPP, qui se réunissent sur sollicitations de la DGS, pour répondre « en urgence » aux demandes des investigateurs.
C’est un réel effort pour les CPP comme pour l’ANSM et c’est normal, car l’on ne peut pas faire d’essai sans qu’il soit évalué en amont, c’est important pour la recherche scientifique et c’est important pour la sécurité des patients. L’intérêt pour un essai clinique est d’être validé par des comités pluridisciplinaires, c’est le fer de lance de l’éthique. Il faut des scientifiques, des médecins, des infirmières, des juristes, des éthiciens, des RU et que ces gens-là se réunissent. Ce n’est pas pour autant une « usine à gaz », les Comités ont l’habitude de rendre des avis et sont réactifs, c’est pourquoi le travail de préparation des dossiers en amont est important. Cette préparation est le fait de la responsable administrative qui est personne « pivot » d’un CPP. Elle est le véritable chef d’orchestre d’un CPP et permet la circulation du dossier entre les investigateurs cliniques, les promoteurs et les membres du CPP. Un essai validé garantit un bon objectif, un bon nombre de patients, un bon nombre de prélèvements, des bons critères d’évaluation et permet de répondre à la question posée. La polémique qu’il y a eu autour de l’essai du Professeur Raoult vient du nombre de patients et de l’objectif flou ne permettant pas à l’essai clinique de prouver que l’hydroxychloroquine a un effet thérapeutique sur le Covid-19. L’Europe a monté un essai qui s’appelle Discovery de 3200 patients avec une première analyse intermédiaire à 15 jours. Cet essai a pour objectif de connaître l’effet anti SARS-CoV-2 de différents traitements dont l’hydroxychloroquine et à quel stade de la pathologie. 40 patients seront inclus à Toulouse.
C’est important pour la sécurité du patient et c’est important socialement pour qu’on puisse dire aux français, ce médicament on est sûr qu’il fonctionne ou ce médicament on est sûr qu’il ne fonctionne pas. Ce n’est pas une histoire d’égo ou d’intuition. Avec Discovery on devrait avoir la réponse dans les prochains jours (avril 2020).
Est-ce que les essais COVID sont priorisés par rapport aux essais non-COVID ?
Ils ne sont pas priorisés, l’on va examiner de façon « classique » les dossiers en cours, nous avons une réunion du comité « prévue » le 7 mai prochain, on reçoit déjà des dossiers. Les dossiers COVID, viennent en plus ou sont examinés sur sollicitations de la DGS lors des réunions « extraordinaires ».
En revanche, actuellement les promoteurs des essais sont tout de même un peu plus focalisés sur COVID que sur le reste, mais rien est arrêté.
Concernant les modalités de consentement des essais COVID : y a-t-il des spécificités ?
Non ! le consentement c’est la pierre angulaire d’un essai clinique. Le patient doit donner son consentement et j’insiste : de façon libre et éclairée. On ne peut pas réduire les temps de présentation et d’explications de l’essai et il y a un temps de réflexion incompressible pour le patient. Donc cela ne peut pas, même en tant de crise, être remis en question.
Ensuite, tout comme en absence de pandémie, les cas où le patient ne peut pas consentir parce qu’il est inconscient sont prévus. Prenons l’exemple d’un patient intubé et sédaté, il est inconscient, ne peut pas prendre une décision, il ne peut pas donner son consentement même si on veut lui administrer une molécule. Dans ce cas, la loi prévoit deux choses : soit le patient a prévu qu’un jour il ne puisse pas donner son consentement et il a désigné ce que l’on appelle une personne de confiance et les médecins vont expliquer l’essai à la personne de confiance qui va prendre la décision pour le patient, au nom du patient ; soit il n’y a pas de personne de confiance et on va interroger l’un de ces proches, qui va donner ou non le consentement. Dans le cas où le médicament aura été administré à un patient avec l’accord soit de la personne de confiance soit d’un proche, dès que le patient sera de nouveau conscient, il lui sera demandé de confirmer ou d’infirmer son consentement. J’insiste sur le fait que rien n’est administré à un patient sans qu’il le sache, ou que la personne de confiance ou les proches le sachent en France. Pour résumer, il n’y a pas de spécificité, l’on fait comme d’habitude.
L’impact de la crise actuelle sur les essais non-COVID
Pour les essais non COVID y a-t-il des difficultés de recrutement, biais, report ?
Non, on en rencontre pas, cependant je vais moduler mon propos.
Pour les essais non-COVID, il n’y a pas de limitation parce que les CPP continuent à se réunir tous les mois en vidéo-conférence sécurisée. Les essais COVID sont étudiés en « réunions extraordinaires » entre les réunions prévues. Donc les dossiers cliniques non-COVID sont traités à la même fréquence.
Là où je souhaite modérer mon propos, c’est que beaucoup d’essais non-COVID qui sont en cours actuellement sont gênés par le fait que beaucoup de patients ne veulent ou ne peuvent plus aller à l’hôpital craignant d’être contaminés par le COVID, donc il y a eu des aménagements dans certains essais pour que les médicaments soient délivrés au domicile du patient ou que les prélèvements sanguins soient faits par des infirmières à domicile afin que le patient ne soit plus obligé de venir à l’hôpital. Il y a donc eu des adaptations de certains protocoles. La surinformation médiatique pas toujours fiable est aussi un problème, nous avons eu le cas de personnes âgées, diagnostiquées COVID+ qui refusent d’intégrer un essai à l’hôpital (ou même un traitement) au motif qu’elles ne veulent pas prendre la place de patients moins âgés. Nous leur expliquons qu’elles ne prennent la place de personne, c’est important. Covid ou pas, tous les patients doivent continuer leurs soins.
Le rôle de représentant des usagers – RU en CPP
Quel est selon vous la force et l’importance du rôle de RU en CPP ?
Le rôle du RU est primordial dans un CPP. Tout d’abord, un CPP c’est un groupe qui est pluridisciplinaire, on est vingt-huit et il y a deux collèges. Le collège 1 est plutôt scientifique, des médecins, infirmières, des chercheurs et dans le collège 2 siègent les RU, les travailleurs sociaux, les juristes, etc. Les deux collèges ont la même force. Les RU ont autant droit de vote et au-delà, autant de poids que n’importe quel membre dans le Comité. C’est une procédure collégiale. Chaque dossier clinique est évalué à la fois par les membres du collège 1 et par les membres du collège 2 dont les RU font partie. Si l’on a pas la présence de l’un des deux RU à notre Comité l’on ne peut pas siéger, c’est la loi. Les RU en CPP sont nommés pour 3 ans (renouvelables).
Dans la richesse des débats autour des dossiers, le point de vue des RU est vraiment important car il met en lumière des aspects que les médecins, les juristes, etc. ne voient pas forcément.
Les RU sont très actifs au sein du Comité, les discussions sont toujours animées, les RU interviennent à tous les niveaux, sur chaque dossier, ils donnent leurs avis, leurs points de vue en tant qu’usagers. Ils permettent l’amélioration des notices de présentation des essais et des lettres de consentement, ils clarifient des éléments, s’assurent que tout est réglementaire. Leurs avis sont précieux. C’est un réel partenariat, le RU est en interaction avec tous les membres du Comité, c’est une pièce maîtresse de la pluridisciplinarité, toujours dans un effort positif d’amélioration et de faire progresser les médecins qui proposent des essais cliniques.
La procédure en CPP est collégiale, tout le monde à sa place, tout le monde est important et au même titre. C’est grâce à cette collégialité que l’on arrive à faire progresser la recherche en France et surtout concourir à la protection des patients.
En cette période inédite de confinement, on travaille bien, on garde du lien avec les RU même en dehors des réunions de CPP, l’on se contacte par mail. Il ne faut pas oublier que les RU sont bénévoles et consacrent un ou deux jours par semaine au CPP. Il y a de l’enthousiasme dans nos échanges !
Des sièges sont-ils à pourvoir en Occitanie ?
Il y a quatre CPP en Occitanie, des postes de RU sont à pourvoir :
- CPP Sud Méditerranée III (siège Nîmes)
- CPP Sud Méditerranée IV (siège Montpellier)
- CPP Sud-Ouest et Outre-Mer 1 (siège Toulouse)
- CPP Sud-Ouest et Outre-Mer 2 (siège Toulouse)
Les formulaires de candidature sont disponibles via le lien ARS Occitanie ci-dessous :
Documentation :
Le Professeur Bettina Couderc recommande cette article « Essai clinique et traitement : quelle éthique en cas d’urgence sanitaire ? » :
——————————–
[1] Madame le Professeur Bettina Couderc est engagée dans différents comités d’éthique hospitaliers, Professeur de Biologie moléculaire et Biotechnologies à l’Université Toulouse III Paul Sabatier / Institut Claudius Regaud, Centre de Recherches en Cancérologie de Toulouse.
Contact(s) communication :
France Assos Santé Occitanie : tel : 05 34 30 24 35 ; mail : communicationFASOccitanie@france-assos-sante.org

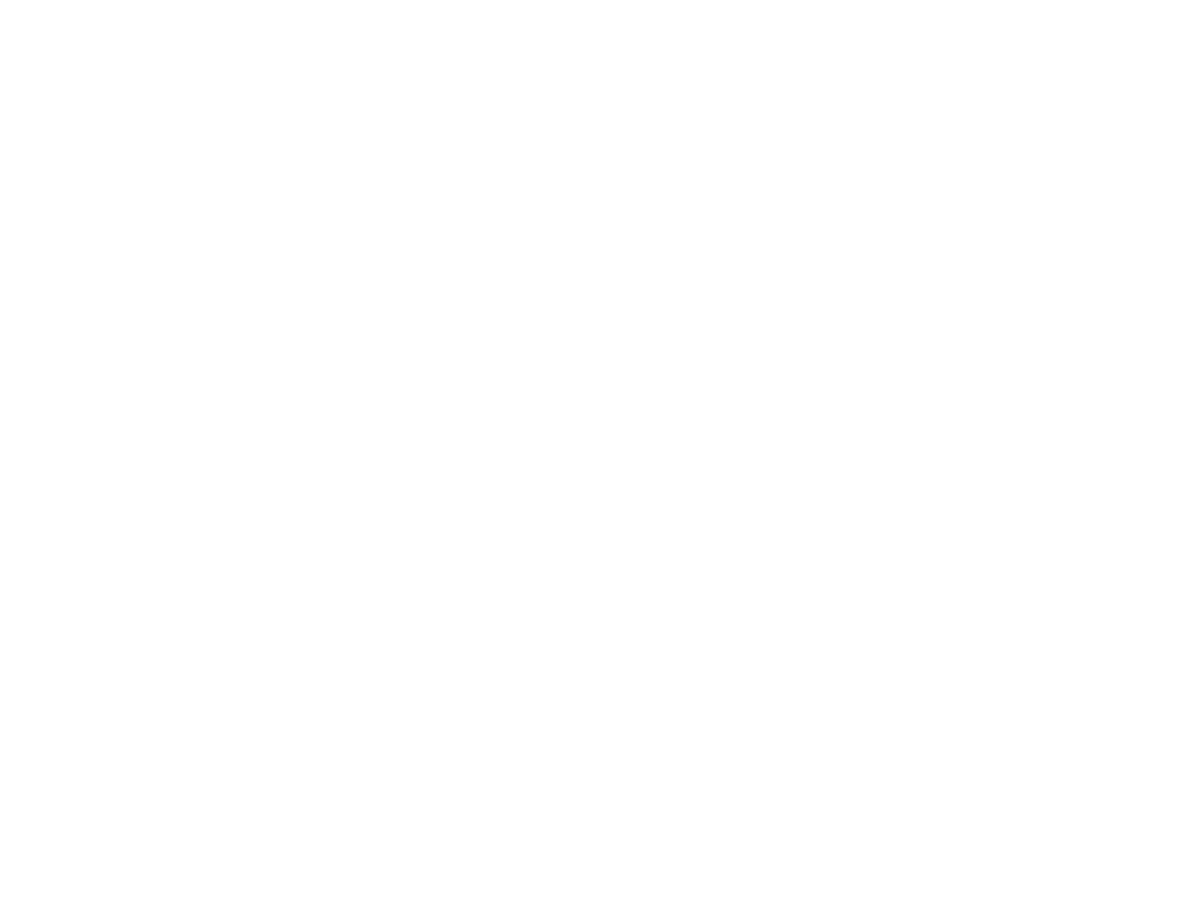

Laisser un commentaire